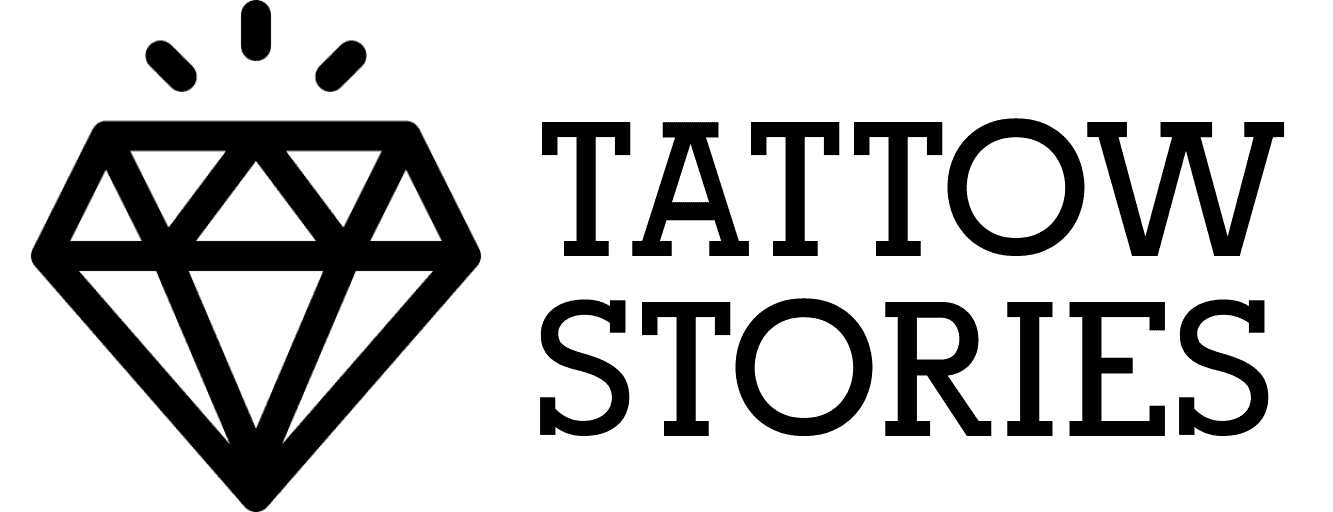Dans cet article, je dresse le panorama culturel d’une pratique du tatouage dans un pays, cette fois-ci, le Japon. Cette deuxième partie évoque une évolution complexe du tatouage dans la société nippone, de son apogée à son bannissement, du rituel des natifs à l’Irezumi traditionnel stylisé par les artistes de l’Ukiyo-e et les graveurs du Mokuhanga.
une pratique autochtone
Pendant la période Kofun (300 av. J.-C. — 600 apr. J.-C.), avec une présence majoritaire de l’ethnie wa sur l’archipel du Japon, la marque encrée fut associée à l’archaïsme autochtone, comme avec le sinuye, le large sourire des femmes Aïnous, ou le hajichi, les petits haricots sur les mains des Okinawaïennes. Durant l’ère d’Edo (1603-1868), le shogunat Tokugawa publia à plusieurs reprises des décrets pour empêcher ces rituels dits « barbares ». Cependant, les premiers peuples, ancrés dans leurs coutumes, ne se soucièrent guère de cette législation. Malgré cette aversion des wa, le tatouage devint en vogue auprès des ouvriers et même des riches marchands, au cours du 17e siècle.
On retrouve une première référence à l’Irezumi dans les quartiers de plaisirs. La courtisane jurait fidélité au client en inscrivant définitivement son nom sur sa peau laiteuse. Outre ce graffiti romantique, un style sophistiqué plus proche de l’Irezumi traditionnel, se propagea dans certains corps de métier comme celui des hikyaku (coursiers) et des tobi (pompiers). Ces personnages folkloriques incarnèrent une esthétique raffinée du tatouage à l’étranger. En studio, ils furent mis en scène pour la création de cartes postales colorisées à la main et diffusées dans le monde entier au début du 19e siècle.