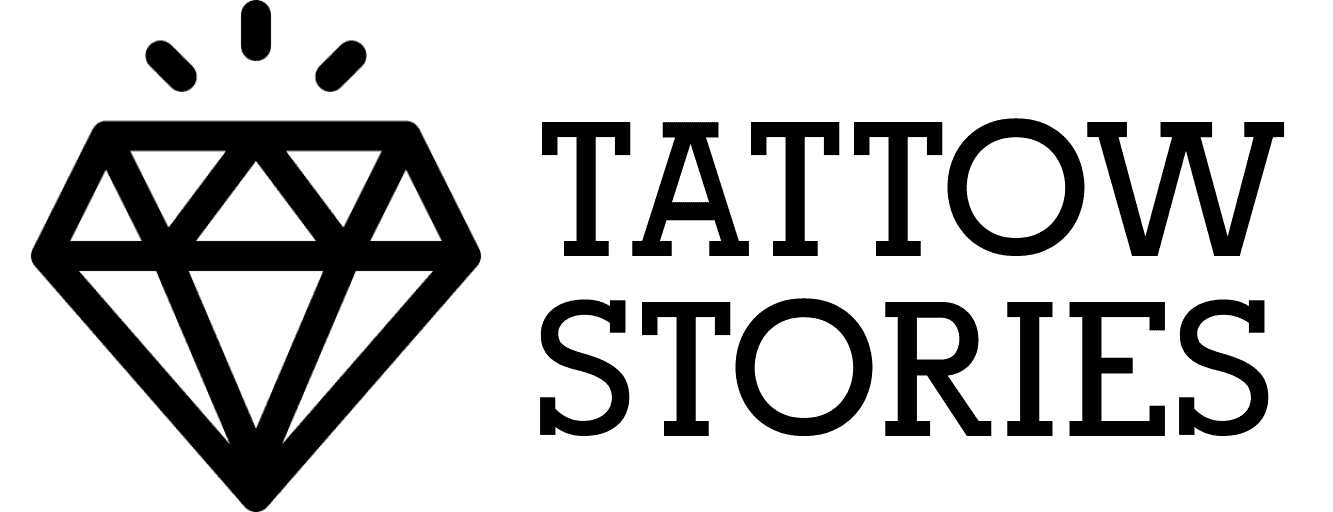La prostitution est « la plaie » que toutes les sociétés dites « civilisées » tentent de maîtriser depuis des millénaires. Entre 1830 et 1930, c’est l’âge d’or des maisons de tolérance en France, les fameux bordels. Le système réglementariste encadre les activités de la prostitution légale. Cependant, sur les trottoirs, les insoumises font de la résistance. Sous la protection du souteneur, ces tatouées de petite vertu troublent l’ordre public.
Texte : Alexandra Bay – Article publié dans Tatouage Magazine
En France, entre 1830 à 1930, c’est la grande époque des maisons de tolérance. Les prostituées qui y exercent leurs talents sont appelées « filles publiques ». Depuis le XIXe siècle, le système réglementariste encadre l’amour vénal de manière drastique. En façade, les politiques maîtrisent le vice et préservent la tranquillité des foyers bourgeois. En réalité, la misère intensifie le phénomène des insoumises. Sur le trottoir, ces femmes tatouées perturbent les bonnes mœurs. Souvent endettées et sans attaches, elles vendent leur corps pour quelques francs. Elles vivent de l’un des plus vieux métiers du monde.
Le plus vieux métier du monde
Et pour cause… La prostitution se retrouve dans toutes les sociétés depuis des millénaires comme les prostituées de Babylone, les hétaïres ou courtisanes de la Grèce antique et les esclaves sexuelles de Rome. Et à ces différentes époques, le tatouage orne déjà les peaux, hommage divin ou au contraire, marque d’infamie. À Babylone, 5 000 ans avant Jésus-Christ, les danseuses ou les musiciennes se font tatouer le signe de leur saint-patron Bès sur les cuisses. Elles améliorent ainsi leurs performances artistiques. Les femmes se produisent dans les maisons de bière. On les écoute, on les admire et on paie pour goûter à leurs charmes. Certaines officient dans les temples, ce sont les prostituées sacrées. Les fidèles s’unissent avec elles pour approcher la divinité, au plus près. Selon une légende, le temple d’Aphrodite, déesse de l’amour, aurait abrité plus de mille prostituées sacrées.